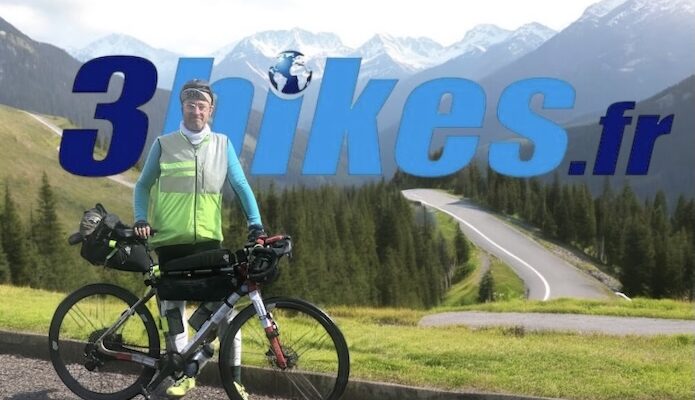Partager la publication "Nicolas Bodin se lance dans la diagonale du cœur"
Il y a dans la voix de Nicolas Bodin quelque chose de tranquille, une manière de parler simple, un peu rêveuse, qui donne envie d’écouter. On sent chez lui cette douceur des instituteurs qui savent transmettre, mais aussi une force intérieure, presque têtue, celle de ceux qui se lèvent chaque matin avec un but clair : faire un peu de bien autour d’eux. Ce samedi 18 octobre, Nicolas s’élance dans un périple de 1700 kilomètres à travers la France. Il l’a baptisé La Diagonale des faibles densités, un nom qui, à lui seul, dit déjà beaucoup : le goût du territoire, de la lenteur, des routes oubliées, des villages qu’on traverse sans les voir et où pourtant, la vie bat encore…
Par Jeff Tatard – Photos : @nikovelotour / NIKOVELOTOUR.COM
Mais derrière ce défi sportif hors norme, il y a un autre combat, infiniment plus grand : celui de l’association L’École à l’Hôpital, qui accompagne les enfants malades pour que la maladie ne les coupe pas du savoir, de la curiosité et du monde. C’est pour eux que Nicolas pédale. Chaque mètre, chaque montée, chaque fatigue aura un sens : celui de rendre hommage à ces enfants qui se battent, à ces enseignants qui continuent d’enseigner dans les chambres d’hôpital, et à ces bénévoles qui redonnent de la lumière là où tout pourrait s’assombrir.
Une carte, une fille, un déclic
Tout est parti d’un dîner banal, dans une cuisine de famille… Sur le mur, une vieille carte de France, un peu jaunie, de celles qu’on accrochait autrefois dans les salles de classe. Nicolas la garde là comme un clin d’œil à son métier de professeur des écoles, et sans doute aussi comme un repère, un rappel de ce qu’il transmet chaque jour à ses élèves.
Ce soir-là, l’une de ses filles lève les yeux vers la carte et lui demande :
— « Papa, c’est quelle ville où tu n’es jamais passé à vélo ? »
Il réfléchit un instant, puis répond : « Saint-Dizier, je crois… »
Elle réplique aussitôt : « Tu sais que cette ville est dans la diagonale du vide ? »
Le mot le frappe. La diagonale du vide. Un concept appris dans les cours de géographie, qui désigne cette grande bande du territoire français où la densité de population est la plus faible. Mais dans cette remarque d’enfant, Nicolas entend autre chose : une promesse d’aventure, de découverte, et une sorte d’hommage à ces territoires qu’on ne regarde plus, mais qui forment le cœur battant du pays.
Ce jour-là, il devait justement partir pour un Paris-Luxembourg caritatif au profit de L’École à l’Hôpital. Il a finalement renoncé pour garder sa fille. C’est à ce moment précis que le déclic s’est produit : « Je me suis dit banco. Ce sera un nouveau défi, une nouvelle manière d’agir pour l’association, et peut-être un moyen de renouer avec ce que j’aime le plus : aller à la rencontre des gens. »
Le soir même, il se plonge dans des lectures sur la diagonale du vide. Et dans sa tête, le voyage commence déjà.
Une diagonale pleine de sens
Le nom du défi, La Diagonale des faibles densités, n’est pas anodin. C’est un contre-pied poétique, une manière de rappeler que ce qu’on appelle “vide” est souvent plein de richesses : d’histoires, d’accents, de solidarités, de paysages.
Pour Nicolas, c’est une France à visage humain : celle des cafés de village où les gens prennent encore le temps de se parler, des boulangeries qui ouvrent à l’aube, des routes bordées de champs, des territoires qu’on dit “oubliés” mais qui ne demandent qu’à être regardés. « Je crois qu’en traversant cette France-là, on comprend mieux le pays dans lequel on vit. On découvre des gens passionnés, des projets, des villages qui renaissent… Et moi, j’aime donner du sens à mes périples en les plaçant sous le signe de la rencontre. »
Ce n’est pas une course, ni une quête de performance. C’est un voyage intérieur autant qu’extérieur, une façon de se reconnecter à la fois au territoire et à soi-même.
L’École à l’Hôpital, une promesse tenue
Derrière le défi, il y a une cause. Et derrière la cause, une histoire personnelle. Il y a une dizaine d’années, l’une de ses filles avait été hospitalisée une semaine. Par hasard, dans les couloirs de l’hôpital, Nicolas croise des bénévoles qui interviennent auprès des enfants hospitalisés pour continuer à leur enseigner, à les accompagner, à maintenir ce lien si fragile entre l’école et la vie. « Leur dévouement m’avait bouleversé. Je m’étais promis qu’un jour, je ferais quelque chose pour cette association. »
Depuis, chaque projet sportif de Nicolas est dédié à L’École à l’Hôpital. Et si son corps fournit l’effort, c’est bien son cœur qui donne la direction.
Une préparation en solo
Rien de professionnel dans tout ça. Pas de staff, pas de voiture suiveuse, pas de partenaire logistique. Seulement un homme, son vélo, et beaucoup de conviction. L’idée de la diagonale n’est venue qu’à la fin de l’été. Alors depuis septembre, Nicolas a enchaîné les longues sorties, quelques courses caritatives, et des séances de course à pied pour entretenir la caisse.
Mais il part aussi avec l’expérience d’un été à 3500 kilomètres sur les routes de France, à la rencontre des habitants et des paysages. C’est un cycliste du réel, de ceux qui savent qu’à 18 heures, dans un petit bourg, la chasse à la nourriture devient un sport à part entière.
Il prépare chaque étape, repère les points de chute possibles : auberges, warmshowers, particuliers, parfois même un abribus ou un sas de banque. « Souvent, je dors là où la route me pose. Ce n’est pas toujours confortable, mais c’est aussi ce qui fait la beauté du truc. »
L’appel du Sud-Ouest
Quand on lui demande quelle portion l’attire le plus, il n’hésite pas : l’arrivée à Hendaye. Après des centaines de kilomètres à traverser la France du nord-est au sud-ouest, toucher la côte basque aura une saveur particulière. « C’est le point le plus au sud-ouest de la France. Et puis, on passe dans des villages qui sentent le rugby, ce sport de clocher que j’ai pratiqué. »
Mais avant ça, il y aura la Tulle-Montauban, l’étape qu’il redoute le plus. Beaucoup de dénivelé, une distance longue, et cette sensation de traverser “le vide”. Il sourit : « C’est justement ce que je viens chercher. »
Seul, mais jamais isolé
Rouler sans assistance, c’est un choix. Un pari sur soi-même, un pacte avec la solitude. Cela veut dire gérer son sommeil, sa nourriture, ses pannes, ses doutes. Cela veut dire se fier à soi et à la route, accepter de ne pouvoir compter que sur ce qu’on a dans les sacoches… et dans le cœur. « C’est comme dans la vie : il faut faire des choix. Ne pas trop se charger. Trouver le bon équilibre. Tout est plus compliqué sans voiture suiveuse, mais tout est plus beau aussi. »
La fatigue ? Il la gère par des micro-siestes, parfois sur le bord de la route. La solitude ? Il la transforme en rencontres. Car dans chaque village, il y a toujours quelqu’un pour lui demander d’où il vient, où il va, et pourquoi il fait tout ça. Et ces échanges, aussi brefs soient-ils, sont pour lui la vraie récompense du voyage. « Je n’ai pas peur de la solitude. Ce que je crains le plus, c’est de manquer d’eau ou de nourriture. Mais même ça, on apprend à le gérer. »
Le professeur et le cycliste
Nicolas est instituteur. Et ça s’entend dans sa manière d’être, dans cette rigueur tranquille qu’il applique à tout ce qu’il entreprend. Avant de partir, il vérifie chaque détail : lumières, équipements, traces GPS. Mais il sait aussi lâcher prise. Les erreurs de parcours, les imprévus, les rencontres — tout cela fait partie du voyage. « C’est aussi une forme de rêverie qu’il est bon de cultiver. » La rigueur, oui. Mais aussi la poésie.
La cause, la passion et la résilience
Dans son regard, on sent la sincérité d’un homme habité. Il parle de la cause avec respect, sans pathos. Il parle du vélo avec gratitude. Pour lui, le vélo est un outil de liberté, de lien et de résilience. « Je ne fais pas de compétition. Ce que j’aime, c’est le voyage, intérieur et extérieur. C’est d’aller vers les autres, de créer du lien, de comprendre la vie ailleurs. Et puis le vélo m’aide à passer des caps, à sortir des difficultés. Chaque périple est une forme de résilience. » Il ne cherche pas à prouver, mais à traverser — le pays, le temps, et ses propres failles.
Le geste citoyen
À la fin de chaque étape, Nicolas pratiquera le plogging, cette activité qui consiste à ramasser les déchets tout en courant. Un petit geste, mais un grand symbole. « J’avais lu un article là-dessus il y a un an, je l’avais expérimenté pendant un mois. Ça m’a marqué. Et je me suis dit que je pouvais le faire sur mon défi. Parce qu’un engagement n’en empêche pas un autre. » C’est sa façon à lui de rappeler que l’effort n’a de valeur que s’il sert à quelque chose de plus grand que soi. Que le sport, au fond, est un outil d’éducation, de lien, et parfois de réparation. « Le sport doit montrer que tout est possible, quel que soit son niveau. Il doit aussi rappeler qu’on peut donner de sa force, de son temps, au service d’une cause. »
Un idéal de société
Quand on l’écoute, on se dit que Nicolas Bodin est un utopiste, mais du genre actif. Pas celui qui rêve les bras croisés, mais celui qui pédale pour prouver que les choses peuvent bouger. Il a même des idées très concrètes : « Pourquoi ne pas taxer à 1 % les transferts dans le sport professionnel pour financer les associations et les clubs ? » Ce n’est pas une boutade. C’est une conviction. Donner du sens, du temps, et un peu de justice à un monde qui en manque parfois.
Ce que l’aventure lui apprend
Quand il parle de ce que lui apprend ce défi, il ne parle pas de watts, de vitesse ou de performance. Il parle de rêve, d’humilité, de transmission. « Il m’apprend à rêver en traçant mon parcours. Il m’apprend l’humilité parce que rien n’est jamais acquis. Il m’apprend la résilience, à croire que le meilleur est toujours devant. Et j’espère que cela inspirera mes enfants, leur montrera que tout est possible, à condition d’y mettre du cœur et de servir les autres. »
Une trace dans les consciences
Ce que Nicolas espère, ce n’est pas qu’on se souvienne de lui, mais de ce que son histoire aura éveillé chez les autres. « Quand quelqu’un me dit que ma rencontre lui a redonné confiance en un monde moins égoïste, je me dis que j’ai gagné la journée. » Alors oui, si son aventure peut inciter quelqu’un à se remettre au sport, à donner de son temps, à trier ses déchets, à réduire ses vols en avion… il se dira que tout cela en valait la peine.
La leçon d’un instituteur
S’il devait s’adresser à un enfant, à un jeune, à un lecteur, Nicolas ne chercherait pas à faire la morale. Il dirait simplement : « Fonce. Lance-toi. Construis ton projet, et tu en seras fier. Certains te diront que c’est inutile ou fou. Mais si toi tu trouves du sens à ce que tu fais, alors c’est l’essentiel. Et même si tu échoues, tu auras déjà gagné. » C’est peut-être ça, finalement, la diagonale des faibles densités : un chemin où la densité d’humanité est maximale.
Épilogue
Dans quelques heures, Nicolas prendra la route. Seul, sans assistance, avec ses sacoches, ses cartes et son sourire. Il traversera des forêts, des plaines, des collines, des villages aux noms modestes, des cafés où on sert encore le demi à la main. Il parlera, écoutera, ramassera des déchets, fera des pauses sur des bancs, dormira parfois à la belle étoile.
Et chaque matin, en remontant en selle, il pensera à ces enfants hospitalisés pour qui apprendre est un acte de résistance, à ces enseignants qui continuent de transmettre malgré les murs, à ces bénévoles qui rappellent que la solidarité n’est pas un mot creux.
Oui, Nicolas Bodin va tracer sa diagonale. Mais ce qu’il dessine, en vérité, c’est une carte du cœur, celle d’une France qui avance encore à la force du courage, du lien et de la bonté.
=> Tous nos articles Portraits
Partager la publication "Nicolas Bodin se lance dans la diagonale du cœur"